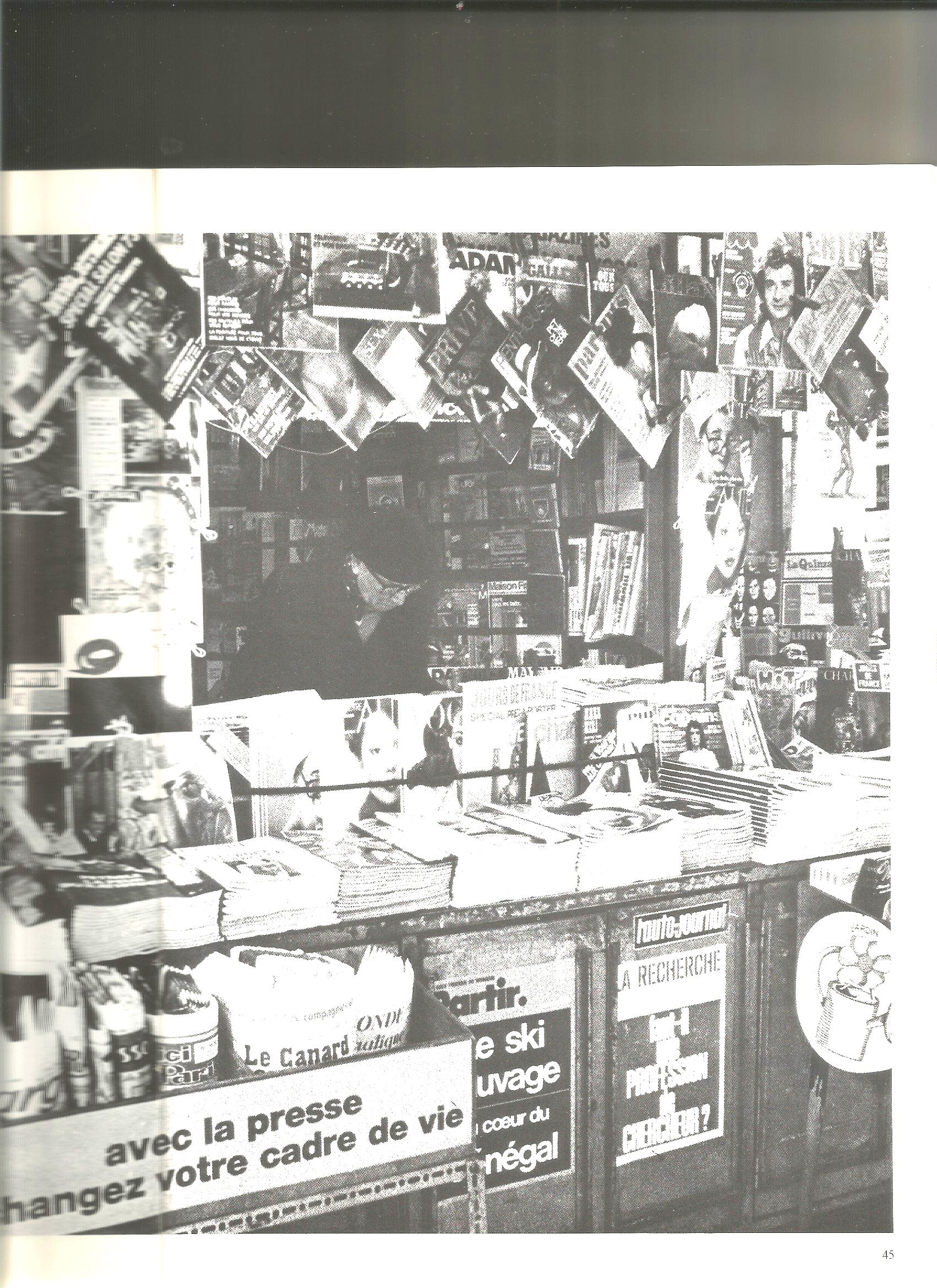|
||
|
L’ATELIER PHILO…
Historiquement, « l’atelier
philo » s’inscrit à la fois dans la continuité et la rupture des « cafés
philo » des années 1995-2005.
-
Dans
la continuité, car il ne s’agit pas de conférence, ni d’exposé, (même suivi d’un
débat), de la part de quelqu’un qui, possesseur d’un savoir, viendrait le transmettre ;
chaque participant, quelle que soit sa compétence, s’exerce à exprimer son propre
point de vue, sur lequel il permet ainsi, à chacun, d’opérer un travail de
compréhension et de critique.
-
Dans
la rupture aussi, par conséquent, car ce travail en commun devient l’aspect principal
de l’atelier.
|
||
La façon dont est formulé le sujet pourrait suggèrer une antinomie entre le processus de l' « apprentissage » et celui de la « compréhension» : ou j'apprends, ou je comprends. Mais cette contradiction ne serait-elle pas fictive ? Cette formulation n'émanerait-elle pas, au contraire, d'un désir de pointer l'impossibilité de dissocier les deux processus : comprendre et apprendre ne seraient-ils pas intimement liés ? Pour répondre à ces questions, il semble nécessaire de déterminer dans quel champ se situe « l'objet » de la compréhension/apprentissage : est-ce celui de la réalité matérielle ? Ou bien celui de la réalité animale ? Ou bien encore celui de la réalité Humaine ? Ou bien enfin celui de la réalité abstraite de la Pensée ? Ces champs entrainent-ils une différence de rapport entre les deux termes ? En ce qui concerne le champ de la réalité matérielle, l'apprentissage pour comprendre comment fabriquer « un objet » (au sens large du terme) semble s'imposer : pour réaliser une « mortaise », il faut posséder la connaissance du matériau à travailler, celle de la spécificité des outils dans leur fonction, et enfin du « coup de main » quant à leur utilisation. Il faut « acquérir » un savoir-faire. En ce qui concerne le champ de la réalité animale, le corps, dans sa matérialité, demande aussi une étude, une observation, un apprentissage limité mais parfois sophistiqué (cf.vétérinaire) pour comprendre son fonctionnement ou son disfonctionnement. Quant aux états intérieurs , dans la mesure où l'animal ne dispose pas du Langage symbolique, mais seulement d'expressions vocales, de mimiques, souvent propres à chaque animal dans sa singularité, il est nécessaire à l'homme de les saisir dans une compréhension- intuitive. En ce qui concerne le champ de la réalité Humaine dont la spécificité est le Langage symbolique, nous sommes obligés de différencier de nombreux domaines : ceux qui ont un objet-propre dont se préoccupe la Science et qui relèvent donc d'une démarche de pensée spécifique, avec son vocabulaire propre qui se doit d'être appris (physique, chimie etc.. / Psychologie, sociologie, histoire, politique etc..linguistique, Mathématique) . Cette démarche de pensée conceptuelle, intimement liée à une pratique, peut procéder par étapes et impliquer une compréhension partielle et provisoire (création d'expériences) qui n'exclut donc ni une connaissance Intuitive pouvant donner la possibilité d'échapper à la Culture du moment , ni l'Imagination irrationnelle dans sa créativité particulière. Cependant, les outils principaux sont bien les idées : idées relevant d'un priori émanant certes d'un apprentissage qui débouchera sur la Compréhension, mais idées également provisoirement retenues pour tirer un enseignement de la réalité ainsi construite : le comprendre précède alors l'apprendre. Au final, reste la Philosophie qui, elle n'a pas d'objet propre sinon le fonctionnement de la Pensée quel qu'en soit le domaine : l'ajustement des Mots (saisir intellectuellement un rapport signe/chose), la précision de leur enchaînement, l'idée claire des causes et des conséquences de ce qui est dit, les liens qui peuvent être faits, le rapprochement des prismes de lecture, etc... . « Mener sa pensée » demande un apprentissage : l'université le fait !! à condition de ne pas s'arrêter au résultat – au Système - somme toute à ce qui peut être pris comme un savoir (histoire de la Philo qui a son utilité dans une autre sphère). Il est primordiale de considérer que nous avons affaire, avec cet intellectuel, à un homme de chair, de sang, d'affects, rivé à une préoccupation intérieure qu'il essaie de solutionner par l'exercice tout à fait spécifique de « sa » pensée; c'est à cet exercice qu'il faut être attentionné , le comprendre et l'apprendre , car il est l' « outil » qui nous est donné pour tenter une connaissance d'une autre réalité sur laquelle nous désirons intervenir. La philosophie n'est qu'un savoir-faire. Pour finir, au niveau de l'existentiel, en quoi le fait d'apprendre et de comprendre peut-il être un problème ? Est-ce parce que l'individu a Peur de perdre son pouvoir sur sa réalité soigneusement installée ? Est-ce parcequ'il a Peur de la découverte de d'autres mondes : je ne lis que des livres qui me confortent dans ce que je pense ou n'écoute que des personnes qui disent la même chose que moi ? Est-ce parcequ'il a Peur de perdre sa place au sein de la société ? Est-ce parcequ'il a Peur de se sentir investi d'une responsabilité : les causes de « sa souffance ou de son insatisfaction » ne seraient pas uniquement extérieures à lui -même ? Est-ce parcequ'il a Peur de la conscience de ses limites ? Est-ce parcequ'il a Peur de ne pas posséder les moyens mentaux pour comprendre ? Est-ce parcequ'il a Peur de ne pas avoir « la force » psychologique de changer ? Quoi qu'il en soit, il semble bien que « comprendre » et « apprendre » exigent le Désir. Mais il est à noter cependant que ce désir n'est pas la seule donnée : il faut pouvoir. Il est vrai que grâce à la mémoire ou à l'intuition, on peut apprendre sans avoir la « possibilité » de comprendre par la raison (cf. le petit enfant, le non-scolarisé ou l'auto-didacte ; ou encore des personnes de milieux culturels différents). Mais il est vrai aussi que , parfois, comprendre ne suscite pas le désir d'apprendre.
Geneviève
Jean Pierre |